|
|
Détail
de la rubrique
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|
Menu
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|
Divers
|
|
|||||||
|
|||||||||
![]()
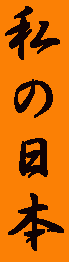
D'EDO A TOKYO : MEMOIRES ET MODERNITES
|
D'Edo à Tôkyô - Mémoires et modernités est un ouvrage publié
en 1988, de Philippe Pons. Celui-ci, journaliste au Monde, a co-dirigé à sa création le centre de recherches sur le Japon
contemporain à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales. Il
a vécu une dizaine d'années au Japon. Son
ouvrage, à mi-chemin entre Histoire et Sociologie, traite d'un
problème cher aux historiens du Japon : la question passé-présent,
tradition-modernité, ici étudiée à travers Edo-Tôkyô sur une
période qui va du règne des Tokugawa à l'époque contemporaine.
Son livre offre une approche originale. Pour Pons, la tradition
est un concept qui n'est pas précis et qui n'explique rien tant
il y a
une diversité de traditions (de classe, de génération).
Plus que la tradition japonaise, policée par les oligarques de
Meiji, c'est plutôt la "culture ordinaire", la culture
populaire et plus précisément urbaine qui fait l'objet de son
livre. Son objectif étant de cerner ce qui fait sa singularité.
Pour lui cette "anti-tradition" a une influence énorme
et reste toujours présente chez les Japonais mais elle est hélas
souvent ignorée du fait de son exclusion de la grande tradition
institutionnalisée par les élites. La mémoire populaire
japonaise est donc formée d'une non-tradition en ce sens qu'elle
ne se considère pas comme une tradition : c'est d'abord une
culture qui s'ignore. La tradition est une notion idéologique
alors que la mémoire est profondément subjective et fait référence
au domaine du vécu. Sur
le plan politique, P. Pons met l'accent sur la modernisation
"silencieuse" sous les Tokugawa. Il y aurait donc une
continuité dans la modernisation depuis 1603 plus qu'une rupture
que symboliserait la révolution Meiji. Cette
modernisation qui va amener le Japon à un système politique
moderne ne vient pas seulement de l'extérieur, l'arrivée du
commandant Perry en 1853 n'est pas la seule cause. Car des forces
venues de l'intérieur du pays, par l'intermédiaire d'une culture
urbaine, que le Japon s'est modernisé. La ville est donc une donnée
essentielle dans le processus de modernisation, ce sera à travers
la ville d'Edo qui se transformera en Tôkyô avec l'avènement de
Meiji que l'auteur nous présentera une Histoire originale et méconnue
du Japon. C'est
donc à Edo que nous commencerons nos recherches, en étudiant les
sources de la mémoire populaire puis l'évolution et l'adaptation
de cette culture. Mais Tôkyô est aussi le symbole d'une modernité
singulière. Sous
les Tokugawa, Edo est la capitale shogunale. Ce rôle politique
confié à la ville va être entre autre la source de son développement.
Au 17ème siècle, c'est une période d'urbanisation qui touche
Edo, qui s'étend de manière concentrique par assimilation des
villages alentours. 1/4 du total des migrations urbaines entre
1590 et 1720 se font en direction d'Edo. La croissance économique
qui en découle est l'une des plus importantes au monde au point
qu'au 18ème siècle, Edo était sûrement la seule ville mondiale
avec Londres à dépasser le million d'habitants. Avec la démographie,
ce sont les transports et les communications qui se développent.
Son port lui assure des échanges commerciaux importants. La
consommation suit cette évolution en augmentant considérablement.
Etant
donné que les Daimyô, les seigneurs locaux avaient comme
obligation de séjourner quelques temps au coté du Shogun, Edo a
acquis un caractère politique. Philippe Pons ne manque pas de
souligner que c'est le lieu primordial de grande tradition : c'est
le théâtre Kabuki, qui était d'abord un théâtre populaire
mais qui, sous la pression de Tokugawa puis des
dirigeants de Meiji s'est peu à peu institutionnalisé, en
interdisant par exemple aux femmes (pour ses raisons morales, les
femmes de ce théâtre étant considérées comme des prostitués).
Pons met le doigt sur un événement : la révolution de Meiji a
eu pour conséquence de normaliser, de policer des activités
culturelles qui auraient pu apparaître aux occidentaux comme
barbares. Cette volonté d'apparaître civilisé, tout en se
constituant une culture nationale forte se traduit aussi par
l'interdiction des sensô (les bains publics) mixtes car ils représentaient
pour les étrangers une manière barbare. Ces établissements
souvent situés en ville étaient très populaires. Signe de
purification associé au rite Shinto et aussi moment intime de
relaxation, où l'on se lave avant d'entrer dans un bain
bouillant. Ce rituel institué par le peuple a donc été normalisé
sous la pression de l'Etat. D'après
Pons, c'est le gouvernement, le politique qu'il soit d'origine
shogunale ou impériale, qui fixe la tradition par sélection donc
par une élimination ou tout du moins une adaptation des rites
japonais. Le but de cette action, c'est bien sûr d'unifier une
fois pour toute la culture japonaise mais aussi de définir une
"japonitude" c'est-à-dire une singularité proprement
japonaise pour construire un Japon fort, une nation moderne. A ce
propos, on observe aussi une mise en valeur de principes considérés
comme "nationaux" : le courage, la vertu, la fidélité,
autant de valeur qui traduisent la volonté de "samouraïsation"
de la société japonaise par les élites d'Edo ou de Meiji.
L'influence du politique est aussi visible à travers la volonté
de politiser l'espace urbain. Sous les Tokugawa, le bakufu a ainsi
voulu séparer la ville d'Edo en quartiers distincts en établissant
une ségrégation sociale suivant les 3 classes. En
effet, toutes ces actions politiques pour normer la population
japonaise à une image n'ont finalement pas détruit la véritable
culture populaire du pays. Culture qui affirme sa singularité
pendant la période Edo. Selon Pons, il ne faudrait pas voir dans
cette époque un Japon féodal immobile ; ces 200 ans ont en réalité
préparée les différentes mutations que va connaître le Japon
à partir de 1868. En somme les Tokugawa, qu'ils l'aient voulu ou
non ont permis un mouvement inéluctable qui s'est concrétisé
par la révolution de Meiji. Aussi fait-il le lien entre culture
populaire et la modernité. Car pour lui, ce sont les représentants
de cette sous-culture en l'occurrence les artisans et les
marchands que l'on peut qualifier de bourgeois au sens étymologique
du terme (gens de la ville)qui ont insufflé
le goût de la modernité au Japon. Considérés comme des
parasites par le pouvoir, il n'en reste pas moins qu'ils ont pu se
développer convenablement du fait de 200 ans de paix intérieure.
A travers la croissance des villes, les Japonais se sont donc
retrouvés de plus en plus nombreux en ville et par conséquent
une culture urbaine est apparue. Elle n'est pas sans référence
à la culture populaire paysanne puisque les immigrants viennent
en grande majorité de villages. Elle a selon Pons, 3 caractéristiques
: ce n'est pas un sous-produit de la culture de l'élite
aristocratique. Elle en est profondément indépendante. Deuxièmement,
elle n'est pas entravée par les interdits religieux (comme en
Occident), elle est plus pragmatique qu'idéaliste. Et enfin elle
est le fruit d'un va-et-vient constant entre la ville et la
campagne. C'est
à Edo que cette culture prend sa source, on parlera d'ailleurs de
culture d'Edo pour qualifier la culture urbaine ou populaire du
Japon.
Elle est très fortement influencée par les mentalités
des marchands : l'esprit d'entreprise, l'enrichissement. Mais
c'est aussi une philosophie du plaisir. Le caractère hédoniste
de cette mémoire populaire se traduit par des pratiques telles
que le sensô (les bains publics), ou la fréquentation des
maisons de prostitution. La
mémoire populaire, loin d'avoir été annihilée par les élites
politiques, s'est développée à la même échelle que le
l'urbanisme augmentait. La
culture populaire s'est transmise de générations en générations
pour finalement perdurer et parfois changer pour s'adapter à la
modernité de Tôkyô. Pour Pons, Tôkyô est soumise à un "surrcodage"
permanent, cela signifie qu'elle trouve son apparence dans la
profusion des signes : qu'ils soient caractères japonais ou
latins. A Tôkyô, des mots apparaissent partout. D'abord c'est la
publicité qui a habilement utilisé cette tradition japonaise des
signes. Des enseignes énormes sur les buildings, des écrans vidéos
qui sont parfois traversés de 3 ou 4 messages de gauche à droite
et de haut en bas. Autant de signes qui démontrent le caractère "lisible"
de la ville japonaise. Au-delà de cet aspect matériel, les
signes se sont affirmés dans la société comme symbole des
rapports entre individus. Par exemple, l'importance de l'uniforme
dans la société japonaise est tel que pratiquement tous les métiers
ont leurs uniformes propres. Et n'oublions pas l'uniforme scolaire
qui reste aujourd'hui un repère essentiel pour les jeunes
japonais. Autre
forme de la mémoire populaire qui perdure, ce sont les formes de
solidarités. Elles ont en fait évolué avec le temps. La forme
traditionnelle de voisinage : le Nagaya (petites maisons les unes
à cotés des autres) fondé sur des communautés de quartiers,
n'existe presque plus de nos jours à Tokyo. Mais elle a évolué
avec l'arrivée des immeubles, et le phénomène d'individualisme,
en associations d'immeubles. Le
goût pour les spectacles reste intact pour la majorité des
Japonais. On notera surtout l'engouement pour les sumô, les
lutteurs traditionnels, liés au culte Shintô. Sport à part entière,
il est retransmis à la télévision et c'est d'ailleurs un des
programmes les plus chers en droit de diffusion. Les
fêtes populaires traditionnelles sont aussi encore aujourd'hui
nombreuses. Des jours fériés leurs sont consacrés. Citons
simplement la fête du feu, de la fertilité, des commerçants,
sans compter les nombreuses fêtes d'écoles. Les
bains publics ont eux eu un destin original : ils vont en fait
fleurir jusque dans les années 1970/80 puis connaître un déclin
progressif. En fait ce n'est pas l'attrait des Japonais pour le
bain qui en est la cause, puisque l'évolution de la société a
fait que c'est vers les sources thermales (onsen) que se tournent
désormais les Japonais. Dans
le domaine des croyances populaires, il y a aussi une continuité.
Les Japonais ont depuis très longtemps une attirance pour le
surnaturel. Un exemple moderne de ce phénomène : c'est la
profusion de bornes automatiques de divination, de la même taille
qu'un distributeur de canettes, qui est censé lire dans l'avenir
de celui qui lui aura introduit 100 yens. Il en ressort un petit
papier (le terme en japonais se prononce de la même manière que
celui de Dieu). Cela montre la continuité de ces croyances et
aussi l'ingéniosité
marketing au service de la culture populaire. L'utilisation
commerciale des traditions
est un phénomène intéressant. De
nos jours des cours privés pour apprendre l'art du Thé sont pris
d'assaut par un public de plus en plus intéressé. La permanence
de cet art est donc liée au fait qu'il représente un marché intéressant.
Pour expliquer l'engouement des Japonais pour ces activités, Pons
note que la démocratisation de l'accès à la culture depuis les
années 50 est allé aussi vite que la croissance économique
japonaise. Cet accès n'est plus hiérarchisé comme sous les
Tokugawa, mais il est cependant aujourd'hui fonction des
ressources de chacun. Il
est amusant de noter que ce sont des banques et des Zaibatsu qui
financent en partie cela. Un exemple : le Parco (un centre
commercial) de Shibuya avait financé une pièce de Kabuki dans
ses bâtiments. Le but n'est pas philanthrope, il résulte d'une
volonté d'attirer le client par des spectacles d'ordinaire hors
de prix dont il peut profiter gratuitement, question d'image
aussi, qui confie à la société un statut d'entreprise de
bienfaisance culturelle. L'évolution
des arts traditionnels japonais a pris un tournant original, à
l'intérieur duquel deux mouvements se croisent : les arts nobles
dépositaires d'une tradition et d'un monopole culturel se démocratisent
: Ikebana, Thé... et ensuite les arts populaires : le Kabuki
autrefois théâtre des marchands s'institutionnalisent deviennent
élitistes. On
l'a vu, les formes de la mémoire japonaise perdurent
au sein d'une société qui n'a plus rien à voir avec
celle d'Edo, en s'adaptant. Le Tôkyô d'aujourd'hui est le fruit
de cela, il en résulte une modernité originale. Modernité
originale donc, qui s'appuie sur une organisation spatiale qui ne
l'est pas moins. Philippe Pons remarque qu'il n'y a pas eu
vraiment de plan d'urbanisme pour la ville de Tôkyô en ce sens
que son développement s'est fait d'une manière organique, par
une croissance démographique non maîtrisée, et par assimilation
de villages alentours. Sur le plan architectural, l'unité
n'existe pas à Tokyo, on privilégie plutôt le présent, l'immédiat
de la construction. Il en conclue même que Tokyo est une ville de
l'éphémère. Cette philosophie de l'immanent au profit du
pragmatisme trouve sa source dans la culture d'Edo. Pons prend
l'exemple de Shinjuku, un des quartiers de Tokyo. Pour lui c'est
le symbole de la modernité japonaise : c'est une mosaïque
d'univers ; il est profondément hétérogène socialement ; on y
croise un yakusa comme une ménagère. Il est aussi le fruit d'un
melting-pot d'images, d'identités et de références.
L'architecture est le signe de cela : le délire d'images se
traduit par des bâtiments à l'architecture kitch (des love hôtels
notamment). Les références à l'Occident sont très présentes
d'abord dans la publicité : on y utilise des mots anglais bien sûr
mais aussi, plus étonnant des termes français, espagnol ou
allemand. La culture Pop contemporaine utilise aussi ses langages
: des groupes de rock à la télévision, des signes étrangers
apparaissent écrits en caractères latins ou en katakana : un des
syllabaires de la langue japonaise (preuve que le brassage
culturel passe aussi par la forme de l'écriture). De même,
l'immensité de Tôkyô et l'absence de sa politique urbaine a
pour conséquence une spatialisation différente, subjective pour
chaque individu. Dans un quartier exempt de visées urbanistes
comme Shinjuku, le piéton doit s'inventer sa propre topologie au
fil de son expérience. Shinjuku est aussi un quartier de la nuit,
et à l'intérieur de celui-ci : Kabuki-chô un
"sous-quartier" en est le symbole. Il devient alors une
nouvelle ville à l'aide de lumières synthétiques. Ce phénomène
montre bien l'importance du plaisir dans la ville, plaisir qu'évoquent
les lieux de distraction comme les Patchinko, ces jeux d'argent
qui tiennent une place prépondérante chez pas mal de Japonais.
Moins dangereux, les kissaten (littéralement le salon de Thé),
les restaurants ou les bars sont d'un nombre incalculable à Tôkyô
; en fait les Japonais ont pris l'habitude de manger dehors plus
souvent qu'à la maison. Le plaisir, c'est aussi la consommation :
les immeubles de Tokyo sont en majorité composés de depatô
(adaptation de departement store) immenses et de magasins divers
et plus petits. Pour
Pons, un outil essentiel pour comprendre l'évolution de la société
japonaise est la bande dessinée. La bande dessinée japonaise (le
manga) est une industrie de la culture de masse du Japon
contemporain. S'il a choisi ce média plutôt qu'un autre, c'est
qu'il est un symbole du "tiraillement entre les valeurs rabâchées
par le discours dominant d'un côté et les tentations d'évasion
de l'autre". Le manga est en somme un symbole de
l'anti-tradition définie en introduction. Il faut noter la
diffusion extraordinaire dont il est bénéficiaire. Chaque
semaine, ce sont des millions de magazines de prépublication de
manga qui sont vendues dans tout le Japon. Diffusion de masse et
donc lecture de masse : dans le train, le métro, les restaurants,
on lit énormément de manga. Produit
de l'époque moderne, il trouve néanmoins ses sources dans une
longue tradition du dessin. L'image était une constituante
essentielle de l'époque Edo. Citons l'ukiyo-e et son représentant
le plus connu Hokusai, mais on peut noter aussi
aux ouvrages illustrés qui se développent au 17ème siècle.
Le Japon de Meiji verra aussi fleurir une pléthore de
caricaturistes. L'après-guerre est le moment où Osamu Tezuka, le
créateur de manga très connus comme Tetsuwan Atomu (Astro boy),
va révolutionner les codes du genre en utilisant dans ses manga
une structure graphique inspirée par le cinéma et de ses
story-board. C'est l'avènement du Gekiga : le manga moderne. Par
la suite, le manga deviendra un média de masse, mais aussi un
vecteur des forces de contestation de l'époque :
des manga marxistes qui traite un sujet sous l'angle de la
lutte des classes aux manga pacifistes de Osamu Tezuka, ce média
suivra de près les mentalités politiques de leur époque. A
partir des années 70, le reflux idéologique laissera sa place à
d'autres genres dont on retiendra le minimalisme. En effet les
manga racontent souvent des histoires simples, inspirées de la
vie quotidienne japonaise en évoquant par exemple les problèmes
d'un étudiant, les relations amoureuses... En
somme, le manga, qui tient sa source d'une part d'une tradition
japonaise de l'image héritée de la culture populaire d'Edo et
d'autre part d'influence américaine ou même occidentale en général,
symbolise bien la dialectique dans laquelle le Japon s'est forgé
sa modernité. Pour
Philippe Pons, la modernisation du Japon portée par la révolution
de Meiji est un phénomène unique en ce sens que le Japon n'a pas
opposé la tradition et la modernité ; cette absence de
contradictions entre ces deux concepts a construit
la transition vers le Japon d'aujourd'hui. Deuxièmement,
il insiste sur les manipulations idéologiques de l'Histoire et de
la tradition par les dirigeants de Meiji. En effet la "samouraïsation"
de la société, qui s'inscrit dans une vision exclusive de la
tradition japonaise est une des raisons du nationalisme naissant
de l'époque, nationalisme qui aboutira aux conséquences
tragiques de la guerre. Philippe Pons aura donc tenté de
distinguer ce qui fondait et ce qui fonde toujours aujourd'hui la
mémoire populaire, en faisant attention de ne pas tomber dans le
piège d'une mémoire idéologique, celle des élites, qu'il faut
distinguer de celle du peuple. C'est
donc, selon lui, l'"anti-tradition" qu'il faut
aujourd'hui étudier tant elle tient une place énorme mais encore
hélas très peu observée et donc mal connue.
Julien Bouvard
|